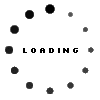Olivier Haralambon - Le coureur et son ombre © DR
Olivier Haralambon - Le coureur et son ombre © DR
Le rouleur amateur partage avec le coureur professionnel une appréhension particulière de l’après. Pour l’un, le quotidien se révèle soudainement terne, voire pesant, au lendemain d’une aventure cycliste qui a marqué son esprit et celui de ses compagnons de route. Pour l’autre, la vie civile et une reconversion précoce, après avoir fait carrière au sein du peloton, sont sources de questionnement et de circonspection.
Amateur et professionnel partagent également le doute, quand les sensations tardent à revenir et que la socquette n’est plus aussi légère. Olivier Haralambon nous le rappelle à merveille au fil des pages de son livre Le coureur et son ombre. Dans ce récit teinté de confidences, cet expert ès pédalage confie sa difficulté à rouler, tel un enfant peinant à trouver le premier équilibre sur deux roues. Si le souvenir des jours véloces reste encore intact, la réalité au guidon est toute autre, l’obligeant à développer un plaisir nouveau.
« Lorsque je monte à vélo vingt ans après ma dernière compétition, et quand bien même me serais-je régulièrement entraîné tout ce temps, je constitue un ensemble nettement moins solide et moins sûr qu’alors. Mes genoux sont susceptibles de trembler sur le braquet telle une mécanique moins bien ajustée qui laisse échapper la compression et, lorsque je monte une côte en danseuse, l’oscillation de ma roue avant est moins affirmée et moins nette qu’elle le fût. Il est probable aussi que je sois devenu à peu près incapable de sprinter, ou qu’alors je serais parfaitement ridicule. Du fond de mon être se lève au fil des ans une onde centrifuge qui finira par me faire trembler si elle atteint la surface. Si je la laisse faire. C’est comme par une sorte d’hésitation de la chair que je suis devenu moins fort, et cette détermination qui claquait autrefois – chaque élément du corps fidèle à son poste -, tel un chariot de machine à écrire, menace de me déserter. Par-dessus le marché, j’avance désormais dans un maquis d’atermoiements prospérant à la façon des ronces, au ras du sol, là où le regard, à tort peut-être, refuse de se poser. Voilà ce qu’il en coûte d’abaisser sa vigilance, de s’imaginer vivre à la proue d’un vaisseau, le sein bombé vers le soleil couchant : on ne voit pas où l’on met les pieds. Mon sang s’est corrompu de phlegme. Je suis devenu fainéant, je pinaille. Les vents qui s’insinuent en mon col sont un problème ; avant chaque sortie, je traque méthodiquement la moindre prise d’air dans ma tenue comme si mes vêtements retenaient mon courage. Et la chaleur des beaux jours m’écrase. […]
À chaque nouvelle séance d’entraînement, il me faut un certain temps, quoique ce temps tout de même s’amenuise de l’une à l’autre, pour coïncider à nouveau avec ma propre chair. Mais j’y parviens toujours, quoique imparfaitement, bien que subsistent des plis d’inconfort. Je m’y réinstalle tant bien que mal. C’est tout le jeu des appuis, meubles comme je l’ai dit, qui me permet de redescendre en mon corps. M’y enfonçant, m’y enfilant, m’ajustant à ma peau, c’est la machine que j’assimile, le vélo que j’incorpore. Dans cette confrontation au monde par le toucher qu’est le cyclisme, mon être pédalant se réincarne : un coup de pédale après l’autre, il prend corps ; un coup de pédale après l’autre, il se soutient dans l’effort et consolide ses liens organiques.
Je m’installe, donc. On verra bien, me dis-je, bien décidé, s’il me faut en baver, à en baver avec style. Quelque chose en moi se souviendra. Je pédale, dons je sens. sans céder à la panique, allez, j’avance, la bouche appliquée entre mes genoux qui montent et descendent. »
> Le coureur et son ombre, Olivier Haralambon, Premier Parallèle, 2017
> Olivier Haralambon a connu l’effervescence du peloton professionnel et l’âpreté du métier de coureur professionnel, avant de décider de canaliser une énergie intacte dans l’écriture et le journalisme. Après s’être essayé au portrait cycliste, racontant dans un premier essai le parcours du fantasque Frank Vandenbroucke, il livre dans ce deuxième élan littéraire un propos plus personnel et délicat.












![Les récits de @theradavist #15 : Bikepacking en Islande [par @weronika.szalas & @louise_philipovitch]
Un récit à retrouver sur www.gravillon.net
#theradavist #islande #bikepacking #gravel #gravillon #gravillonsite #leguidondanslatete #cycling #velo #bicyclette #bicicleta #bicla #bici #bicicletta #bicycle #bike #cycle #fahrrad #自転車 #自行车](https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/434677925_1135952624197328_5255416114559275614_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=Cjtg42Al_fIAb5FuSCL&_nc_ht=scontent-fra3-1.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfC247G-iv0cmw0vXnepWdwkW067aUlblqkYTFgvPEZl_w&oe=66276D72)
![Les récits de @theradavist #15 : Bikepacking en Islande [par @weronika.szalas & @louise_philipovitch]
Un récit à retrouver sur www.gravillon.net
#theradavist #islande #bikepacking #gravel #gravillon #gravillonsite #leguidondanslatete #cycling #velo #bicyclette #bicicleta #bicla #bici #bicicletta #bicycle #bike #cycle #fahrrad #自転車 #自行车](https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/434728572_1089024072374340_6522031998658563747_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=yjAcGKUO_VEAb6TVPLH&_nc_ht=scontent-fra3-1.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfC-8ZZXacFm6z_BPfIoZiCRUS1D0mmiN5LtYLFvzItr1g&oe=662762C6)
![Les récits de @theradavist #15 : Bikepacking en Islande [par @weronika.szalas & @louise_philipovitch]
Un récit à retrouver sur www.gravillon.net
#theradavist #islande #bikepacking #gravel #gravillon #gravillonsite #leguidondanslatete #cycling #velo #bicyclette #bicicleta #bicla #bici #bicicletta #bicycle #bike #cycle #fahrrad #自転車 #自行车](https://scontent-fra5-1.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/434748677_793408039505382_8811633582923561860_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=AxCiYm65gMsAb7D1bTR&_nc_oc=AdgpUKGp0-CXSu7-UHa87WdYu6IhZMNrzLhDAakzhJobP5xnTVrRfpMPSKXkXn1pUFw&_nc_ht=scontent-fra5-1.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfDFJcUeGatDYzg1YqLiTy460SE8DH4vtk-62djrLen2wg&oe=66275504)
![Les récits de @theradavist #15 : Bikepacking en Islande [par @weronika.szalas & @louise_philipovitch]
Un récit à retrouver sur www.gravillon.net
#theradavist #islande #bikepacking #gravel #gravillon #gravillonsite #leguidondanslatete #cycling #velo #bicyclette #bicicleta #bicla #bici #bicicletta #bicycle #bike #cycle #fahrrad #自転車 #自行车](https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/434554261_740757754810333_2438584810417138695_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=85Qb9RfzrbEAb69yFnv&_nc_ht=scontent-fra3-1.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfCAmvbE2uXhuZXBnl4g4MN_25BNZF-RB2gfz_quQhgKRA&oe=6627645E)
![Les récits de @theradavist #15 : Bikepacking en Islande [par @weronika.szalas & @louise_philipovitch]
Un récit à retrouver sur www.gravillon.net
#theradavist #islande #bikepacking #gravel #gravillon #gravillonsite #leguidondanslatete #cycling #velo #bicyclette #bicicleta #bicla #bici #bicicletta #bicycle #bike #cycle #fahrrad #自転車 #自行车](https://scontent-fra3-1.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/434574692_956318069454068_1449396909162467610_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=348-dzxU0GoAb7BCj9a&_nc_ht=scontent-fra3-1.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&oh=00_AfA34Im-bzHqF_YaNUxrLlLViG7_nERFexD8GZ2bZatoog&oe=662753A9)